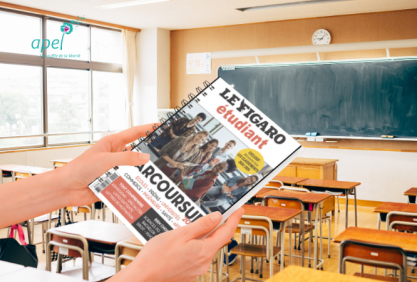«Un modèle qui a fait ses preuves» : pourquoi les classes préparatoires reviennent en force ?
Retour en grâce des classes préparatoires. Depuis la rentrée 2024, 96.900 élèves sont scolarisés dans ces cursus d’excellence préparant aux concours des grandes écoles. Une augmentation sensible de 5,5% en un an avec 4500 élèves de plus sur l’ensemble des filières. La hausse est particulièrement marquée dans les prépas économiques (+8,3%) et scientifiques (+5,5%). Jamais ces formations proposées dans environ 450 lycées n’avaient accueilli autant d’étudiants.
Bien sûr, les lycéens savent que la prépa n’est plus désormais ce monde de concurrence malsaine qu’il a pu être par le passé. Une majorité d’élèves de prépa se disaient même satisfaits de leur formation et affirmaient qu’ils feraient encore le même choix si l’occasion leur était donnée, dans une étude sur le bien-être étudiant publiée début 2024. Mais ce changement de modèle n’est pas d’hier. Là n’est pas l’origine de ce rebond constaté en 2024, après quatre années de baisses consécutives entre 2018 et 2022. Comment l’expliquer ?
Comme beaucoup de professeurs en CPGE, David Denoncin, qui enseigne au lycée Raspail à Paris, pointe plutôt du doigt la réforme du baccalauréat. «Le fait de ne pas mettre de maths dans le tronc commun a été catastrophique», souligne-t-il. L’introduction des doublettes de spécialité, de fait, a laissé croire à beaucoup de bons élèves qu’ils pourraient accéder aux meilleures formations sans poursuivre les mathématiques. Alors qu’un tel choix leur fermait de facto les portes des prépas économiques et scientifiques. «Après une ou deux générations de lycéens, le message a fini par passer», se risque David Denoncin.
La certitude d’une école
Mais la réforme Blanquer, mise en place à partir de la rentrée 2021, ne saurait expliquer à elle seule la baisse d’effectifs qui a démarré dès 2018. Une partie des bacheliers s’est-elle tournée vers d’autres voies, alors que le nombre de possibilités d’orientations s’est démultiplié ces dernières années ? C’est l’hypothèse avancée par Juliette Genzmer, professeure de mathématiques en CPGE au lycée Charlemagne à Paris.
«Les familles ont fini par se sentir perdues. Elles sont revenues au modèle bien connu de la prépa, qui a fait ses preuves», veut croire l’enseignante. «C’est rassurant.» De fait, en dehors de la filière littéraire, les élèves qui s’engagent en CPGE ont quasiment l’assurance d’entrer dans une école. Ainsi, 85% des élèves y parviennent par exemple en prépa scientifique et près de 100% iront in fine jusqu’au master 2, selon l’Union des Professeurs de classes préparatoires scientifiques (UPS). Les proportions sont à peu près les mêmes côté ECG.
L’explication est éclairante pour les prépas commerciales, qui avaient connu le plus net recul. L’arrivée des bachelors dans les années 2010 leur avait porté un coup sérieux. Ces formations postbac en trois ou quatre ans faisaient même craindre une disparition prochaine de la filière. «Mais ces formations souvent très onéreuses, ne garantissent pas toujours un retour sur investissement satisfaisant», selon Cécile Bayle, professeur d’anglais en prépa ECG à Sainte Marie Lyon.
Financièrement, d’abord, la question est vite réglée. Là où un bachelor en école de commerce peut coûter entre 8000 et 20.000 euros l’année, les classes préparatoires sont gratuites dans le public et oscillent la plupart du temps entre 1000 et 3000 euros l’année dans le privé sous contrat. «Entre cinq années chères et deux années gratuites plus trois années chères, on voit bien où est l’avantage des familles», résume Cécile Bayle.
Reconnaissance du parcours prépa - grande école
Surtout, la carrière n’est souvent pas la même une fois dans l’entreprise. «Faire beaucoup de stages, partir à l’étranger immédiatement après le baccalauréat, c’est bien, mais cela n’apporte pas les mêmes compétences d’analyse critique, d’abstraction, de gestion d’une lourde charge de travail, ajoute l’enseignante. Il y a une prise de conscience qu’après un bachelor, on n’accède généralement pas au niveau de salaire et de responsabilité escompté».
Le passage par la classe préparatoire va du reste être valorisé. En 2025, les grandes écoles délivreront avec le master un certificat réservé aux étudiants passés par la classe préparatoire. Une reconnaissance qui n’aura pas la valeur d’un diplôme, mais qui permettra de mettre en avant l’acquisition de compétences particulières auprès des employeurs. Pour les élèves issus des classes préparatoires économiques et B/L un «certificat of Liberal Arts» ; pour les anciens khâgneux de prépa A/L, un certificat «Humanités».
Pour les prépas scientifiques, ce retour en grâce pourrait aussi être lié à l’importance croissante de certains sujets dans l’opinion publique, notamment chez les plus jeunes, comme l’intelligence artificielle ou la transition écologique. «Dans l’esprit des lycéens qui arrivent en première année, la figure de l’ingénieur industriel s’est effacée pour laisser place à ces nouveaux enjeux», constate Victor Bertrand, professeur en prépa filière TSI à Sète. Une aubaine, alors que l’économie française a besoin de 15.000 ingénieurs de plus chaque année, selon la CDEFI. Reste à savoir si la hausse des effectifs se poursuivra en CPGE dans ces prochaines années.
La reproduction de cet article a fait l’objet d’un accord de la part de la société Le Figaro.
L’Apel, en partenariat avec Le Figaro, vous invite par ailleurs à découvrir l’offre Spécial Bac : pour les élèves de première et de terminale, l'abonnement numérique au Figaro est gratuit pendant 1 an.